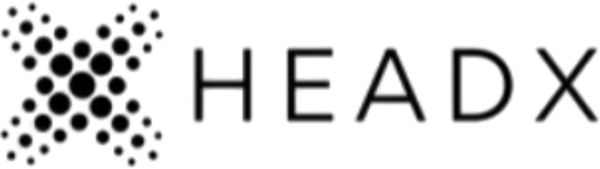Au-delà de la récupération des membres
La réadaptation après un AVC se concentre souvent sur la récupération de la force et de la fonction des membres, mais cette priorité occulte parfois les difficultés plus discrètes et moins évidentes auxquelles les survivants sont confrontés. Outre la faiblesse et les limitations de mobilité, de nombreuses personnes souffrent de troubles persistants de l'équilibre, de l'orientation spatiale et de la coordination œil-tête. Ces problèmes ne sont pas toujours immédiatement visibles, mais ils peuvent compromettre l'autonomie et la confiance en soi tout autant que les troubles de la marche ou de l'usage des mains. Les aborder directement dans le cadre de la réadaptation peut contribuer à combler un vide souvent négligé dans la récupération.
Le rôle de la colonne cervicale
La colonne cervicale est un centre névralgique pour les informations proprioceptives, transmettant au cerveau des informations sur la position et le mouvement. Ces informations interagissent en permanence avec les systèmes visuel et vestibulaire pour maintenir l'équilibre et l'orientation. Lorsqu'un AVC perturbe ces voies, l'intégration entre la proprioception cervicale, la stabilité du regard et le contrôle postural peut être compromise. Les survivants peuvent avoir du mal à détecter la position de la tête dans l'espace, ce qui réduit leur capacité à maintenir une posture neutre. Ils peuvent également ressentir des étourdissements, une désorientation ou une dépendance excessive aux informations visuelles pour maintenir leur équilibre. Des recherches ont montré que les troubles proprioceptifs de la colonne cervicale sont étroitement liés à une diminution de la stabilité posturale et à une démarche instable, créant un obstacle invisible mais significatif à la récupération fonctionnelle (Treleaven, 2008 ; Bonan et al., 2004).
Coordination œil-tête et fonctionnement quotidien
Les troubles de la coordination tête-œil sont également fréquents après un AVC. Les patients signalent souvent des difficultés à suivre les objets en mouvement, à tourner la tête en douceur ou à coordonner le regard avec les mouvements du corps. Ces déficits peuvent limiter la sécurité des déplacements au quotidien et augmenter le risque de chute. Comme le décrivent Shumway-Cook et Woollacott, le contrôle de la tête et les mouvements oculaires ne sont pas des compétences isolées, mais profondément liées à des systèmes plus vastes d'équilibre et de contrôle moteur, ce qui signifie que même des déficiences subtiles peuvent se répercuter sur de nombreux aspects du fonctionnement quotidien (2016).
Apprentissage moteur et rétroaction
Les stratégies de rééducation qui mettent en évidence ces déficits subtils sont prometteuses. Des données probantes suggèrent que le réapprentissage moteur bénéficie d'un retour d'information immédiat, permettant aux patients de reconnaître les petites erreurs et d'ajuster leurs stratégies de mouvement en temps réel. Les travaux de Winstein sur l'apprentissage moteur soulignent que la connaissance des résultats accélère l'acquisition des compétences, un principe essentiel pour réapprendre le contrôle précis des mouvements cervicaux (1991). Chez les patients ayant subi un AVC, cela peut être réalisé grâce à des techniques de retour d'information visuelle qui rendent les mouvements de la tête plus apparents, permettant aux patients de voir lorsqu'ils s'écartent des positions cibles et avec quelle précision ils reviennent à la position neutre.
Rééducation proprioceptive et équilibre
Un réentraînement proprioceptif ciblé peut ensuite être ajouté à ce feedback. En pratiquant des mouvements précis vers des points précis et en travaillant à rétablir une position neutre, les patients renforcent progressivement les boucles de rétroaction proprioceptive qui favorisent l'équilibre et l'orientation. À mesure que leur tolérance s'améliore, ces exercices peuvent être intégrés à un travail plus large sur l'équilibre et la mobilité. La réalisation d'exercices cervicaux en position debout ou lors d'activités de step favorise la coordination de la tête, du tronc et des membres inférieurs, créant ainsi une meilleure stabilité fonctionnelle.
Intégration cognitivo-motrice
Un autre élément de preuve important concerne l'entraînement à double tâche et l'entraînement cognitivo-moteur. La réadaptation après un AVC reconnaît de plus en plus l'intérêt de combiner la pratique physique à des tâches exigeant séquençage, planification ou attention. Plummer et ses collègues ont démontré que les interventions physiques sollicitant à la fois les systèmes moteur et cognitif peuvent améliorer les résultats dans tous les domaines (2013). Ceci est particulièrement pertinent pour la rééducation du contrôle cervical. Les exercices impliquant le traçage de motifs tels que des cercles, des boucles infinies ou des labyrinthes exigent concentration et séquençage, ainsi que stabilité physique, offrant ainsi une stimulation de réadaptation plus complète.
Applications pratiques en thérapie
En pratique, les cliniciens ont commencé à intégrer des outils qui projettent un point ou un réticule sur un tableau mural, offrant ainsi aux patients une visualisation directe des mouvements de leur tête. Même les plus petits écarts deviennent visibles, permettant au patient et au thérapeute de les utiliser pour orienter la correction. Ce qui pourrait autrement être décrit vaguement comme « essayer de maintenir la tête stable » devient un exercice mesurable, structuré et stimulant. Les patients peuvent commencer par de simples exercices de traçage assis, progresser vers des exercices dynamiques debout, et finalement s'attaquer à des schémas plus complexes associés à des exercices de pas ou à des tâches cognitives. Cette approche s'inscrit parfaitement dans les principes établis de l'apprentissage moteur et de la neurorééducation, tout en étant motivante en rendant les progrès clairs et tangibles.
Des principes à la pratique
C'est dans ce contexte qu'ont émergé des technologies telles que HeadX Kross. Grâce à un retour visuel du contrôle cervical, elles permettent aux thérapeutes d'explorer un parcours structuré et progressif de rééducation de la proprioception et de l'équilibre. Il est important de noter que ces méthodes ne remplacent pas la rééducation conventionnelle, mais la complètent, contribuant ainsi à traiter les déficiences moins visibles, mais tout aussi importantes, qui peuvent persister après un AVC.
Conclusion
La leçon la plus importante est que la rééducation ne doit pas s'arrêter aux membres. La tête et le cou constituent un axe crucial pour l'équilibre, l'orientation et la confiance, et les interventions ciblant ces systèmes peuvent améliorer les résultats globaux. En rendant visible l'invisible, que ce soit par de simples techniques de rétroaction ou des outils visuo-moteurs structurés, les cliniciens peuvent offrir aux patients de nouvelles façons de comprendre leurs mouvements, de s'impliquer davantage dans la thérapie et de suivre leur propre parcours de rétablissement.
Références
- Treleaven J. (2008). Troubles sensorimoteurs dans les troubles cervicaux affectant la stabilité posturale et le contrôle des mouvements de la tête et des yeux – revue critique. Thérapie manuelle, 13(1), 2–11.
- Bonan IV, Yelnik AP, Colle FM, Michaud C, Normand E, Panigot B, Roth P, Guichard JP, Vicaut E. (2004). Dépendance à l'information visuelle après un AVC. AVC, 35(11), 2547–2553.
- Shumway-Cook A, Woollacott M. (2016). Contrôle moteur : traduire la recherche en pratique clinique. Lippincott Williams & Wilkins.
- Winstein CJ. (1991). Connaissance des résultats et apprentissage moteur : implications pour la physiothérapie. Physiothérapie, 71(2), 140–149.
- Plummer P, Zukowski LA, Giuliani C, Hall AM, Zurakowski D. (2013). Effets des interventions d'exercice physique sur la cognition chez les survivants d'un AVC : revue systématique. AVC, 44(7), 2036–2045.