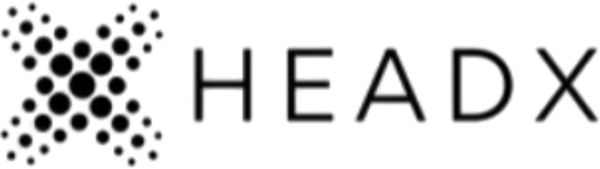Introduction
La kinésiophobie, définie comme la peur du mouvement ou de l'activité physique due à la croyance qu'elle pourrait causer de la douleur ou une nouvelle blessure , est de plus en plus reconnue comme un facteur important de persistance et de chronicité des affections musculo-squelettiques (Kori et al., 1990). Initialement décrite chez des patients souffrant de lombalgie chronique, elle est désormais reconnue comme affectant un large éventail d'affections, notamment les cervicalgies chroniques, les troubles associés au coup du lapin et la convalescence post-opératoire (Luque-Suarez et al., 2019).
Base conceptuelle
La kinésiophobie est mieux comprise à travers le modèle peur-évitement de la douleur (Vlaeyen et Linton, 2000). Ce cadre explique comment les patients qui dramatisent la douleur peuvent développer un cycle de comportement d'évitement. Au lieu de reprendre progressivement l'activité physique, ils restreignent leurs mouvements par peur, ce qui contribue à une mobilité réduite, à une faiblesse musculaire et, à terme, à une aggravation du handicap.
Impact clinique
Il a été démontré que la présence de kinésiophobie est corrélée à :
- Niveaux plus élevés de douleur et d'invalidité (Asiri et al., 2021)
- Temps de récupération prolongés après une blessure musculo-squelettique ou une intervention chirurgicale (Picavet et al., 2002).
-
Qualité de vie et performances physiques inférieures (Demirbüken et al., 2016).
Dans le cas de douleurs chroniques au cou en particulier, la kinésiophobie a été associée à une altération de la proprioception et du contrôle sensorimoteur, suggérant que les mécanismes physiques et psychologiques interagissent (Luque-Suarez et al., 2019).
Évaluation
L'outil le plus utilisé pour mesurer la kinésiophobie est l' Échelle de kinésiophobie de Tampa (TSK) , un questionnaire auto-déclaré évaluant la peur de la douleur et la peur de l'activité physique (Kori et al., 1990). Les scores à la TSK ont été associés à des mesures objectives et subjectives de déficience.
Approches de réadaptation
La lutte contre la kinésiophobie nécessite une approche multidimensionnelle :
Éducation : Aider les patients à comprendre la différence entre un mouvement sûr et un mouvement dangereux peut réduire la peur et la catastrophisation (Vlaeyen et Linton, 2000).
Exposition et exercice gradués : il a été démontré que la réintroduction progressive des mouvements redoutés améliore les résultats (Leeuw et al., 2008).
Entraînement sensorimoteur : des preuves récentes indiquent que les exercices ciblant la proprioception et le contrôle cervical peuvent réduire la kinésiophobie chez les patients souffrant de douleurs chroniques au cou (Tejera et al., 2020 ; Luznik et al., 2025).
Conclusion
La kinésiophobie n'est pas seulement une curiosité psychologique, mais un obstacle cliniquement significatif à la récupération en réadaptation musculosquelettique. Sa présence perpétue la douleur, le handicap et les limitations fonctionnelles. Une prise en charge efficace requiert à la fois une réadaptation physique et des stratégies cognitives, et de nouvelles données suggèrent que les interventions sensorimotrices peuvent jouer un rôle précieux. Les technologies fournissant un retour d'information en temps réel sur les mouvements de la tête et du cou, comme les systèmes laser montés sur la tête comme le HeadX Kross , peuvent aider les patients à reprendre confiance en leur capacité à se déplacer en toute sécurité en rendant les progrès visibles et tangibles.
Références
Asiri, F., Reddy, RS, Tedla, JS, AlMohiza, MA, Alshahrani, MS, Govindappa, SC, & Sangadala, DR (2021). La kinésiophobie et ses corrélations avec la douleur, la proprioception et les performances fonctionnelles chez les personnes souffrant de cervicalgie chronique. PLOS ONE, 16 (7), e0254262.
Demirbüken, İ., Özgül, B., Kuru Çolak, T., Aydoğdu, O., Sarı, Z. et Yurdalan, SU (2016). Kinésiophobie en relation avec l'activité physique dans les cervicalgies chroniques. Journal de réadaptation du dos et de l'appareil locomoteur, 29 (1), 41-47.
Kori, SH, Miller, RP et Todd, DD (1990). Kinésiophobie : une nouvelle approche du comportement face à la douleur chronique. Gestion de la douleur, 3 , 35–43.
Leeuw, M., Goossens, MEJB, Linton, SJ, Crombez, G., Boersma, K. et Vlaeyen, JWS (2008). Le modèle d’évitement de la peur de la douleur musculo-squelettique : état actuel des preuves scientifiques. Journal de médecine comportementale, 30 (1), 77-94.
Luque-Suarez, A., Martinez-Calderon, J., et Falla, D. (2019). Rôle de la kinésiophobie sur la douleur, le handicap et la qualité de vie chez les personnes souffrant de douleurs musculo-squelettiques chroniques : revue systématique. British Journal of Sports Medicine, 53 (9), 554–559. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098673
Luznik, I., Pajek, M., Sember, V., & Majcen Rosker, Z. (2025). Efficacité de l'entraînement du contrôle sensorimoteur cervical pour la prise en charge des cervicalgies chroniques : revue systématique et méta-analyse. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 21 (1), à paraître prochainement.
Picavet, HSJ, Vlaeyen, JWS et Schouten, JSAG (2002). Catastrophisme de la douleur et kinésiophobie : facteurs prédictifs de lombalgie chronique. American Journal of Epidemiology, 156 (11), 1028–1034.
Vlaeyen, JWS et Linton, SJ (2000). L'évitement de la peur et ses conséquences dans les douleurs musculo-squelettiques chroniques : état des lieux. Pain, 85 (3), 317–332.